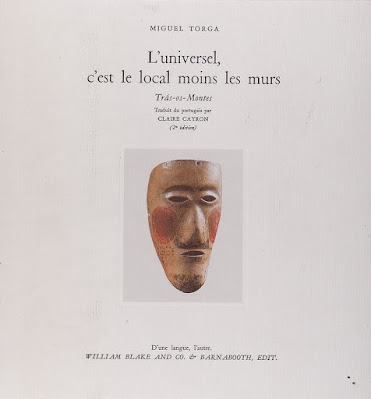Alerte ! Alerte ! (sur l’air du Trouvère de Verdi). Téléspectateurs, sachez
qu’une sorcière envoûte la chaîne et déchaîne l’unité républicaine. La France
prend fin à grands feux ! Mais, ne perdons pas espoir, ça résiste. Trois
semaines de grève, des journaux miniature, privés de direct : voilà le prix à
payer pour que la France ne périsse pas.
«France Télévisions a l’idée derrière
de supprimer l’info nationale et internationale sur France 3.» (Le Télégramme,
22.11.23) Plus de nation : que des régions. Mais quelles régions ?
Et, comme par
hasard, «toutes les régions, sauf la Corse, ont déjà été touchées» par la grève
(Le Monde, 21.11.23).
La Grande Sorcière s’est penchée sur le berceau d’Ici, a
effleuré l’enfant de sa baguette infernale. Qui donc serait aveugle pour ne pas
comprendre de quoi il retourne (et ce dont elle détourne) ? Trève de naïveté :
la patronne des chaînes est devenue la meilleure alliée des dépeceurs de
République, de ceux qui n’aiment pas la France. Redisons-le : «all’erta !
all’erta !» (Il trovatore, acte 1, scène 1)
Chaque région en prend pour son grade. La Bretagne résiste, mais
jusqu’à quand pourra-t-elle tenir ? Par bonheur, la Corse demeure une exception,
après tout c’est une île, et les îles ont l’habitude des port(e)s de sortie,
exit en anglais. Mais la Bretagne ? ces trois doigts plein ouest avec le pouce
normand en arrière-garde, péninsule vigile de l’Hexagone, que dis-je, de
l’Europe, du continent eurasiatique, un cap, comme le nez de Cyrano. Allons-
nous vers un Breizhxit à la mode écossaise ou catalane ?
Heureusement, il y a
une constitution. Le meilleur rempart contre l’émiettement de la France. Du haut
de ses créneaux se profilent une gardienne et un gardien, regard à l’affût et
doigts sur clavier, qui placent l’amour de la France bien au-dessus des tours de
la citadelle sur laquelle ils veillent sans relâche, prêts à tirer sur tout ce
qui bouge. Hélas, la tâche est ample, longue, exténuante, et l’ennemi passe
quand même. Cette grève, qui n’est pas sans effets, n’emporte pas l’adhésion de
tous. Et la gardienne et le gardien n’ont pas vu se faufiler la sorcière, déjà
ils manquent de voix, leurs mousquets sont encrassés. Nous parlerons pour eux.
Autonomiste, séparatiste, indépendantiste, régionaliste, ethnorégionaliste :
voilà les ASIRE! Leur meilleur soutien est cette ancienne élève de grande école,
elle aussi, (Centrale), et née en périphérie. Encore voit-on que ce n’est pas
n’importe laquelle.
ASIRE : le sigle qui recouvre la machine dépeceuse,
marque de la tronçonneuse qui entame, ampute et gangrène l’Une-et-indivisible.
Il ne faut pas faire comme si : ça y est, c’est en marche, ici, là, là-bas. La
peste ASIRE. La gardienne et le gardien savent de quoi ils parlent. ASIRE ce
n’est pas une révolution, mais une destruction. D’Écosse en Corse, l’Europe est
transformée en un puzzle mortel qui, à mesure qu’on ôte l’une de ses pièces,
révèle la couleur de fond : le brun ! Car, en effet, pour la fine bouche, ASIRE
cache deux I : indépendantiste, identitaire !
La démonstration pourrait
s’enrichir du cas irlandais, mais c’est un peu tard : les armes allemandes
débarquées sur le solitaire rivage de Banna (comté de Kerry) avaient été livrées par le Deuxième
Reich.
 |
| U-boot 19. Roger Casement, marqué par une croix, avant la livraison d'armes du Vendredi Saint 1916 (Padraig Og O Ruairc, Revolution, Cork, 2011). |
La récente république d’Islande, avec sa population équivalant à celle de
Rennes et de Brest réunies, c’est trop loin. On laissera aussi de côté ces
confettis qui mouchettent d’exotique archaïsme le visage de l’Europe, San
Marino, Liechtenstein, Città del Vaticano ; Andorra et Monaco restent sous
bénéfice de doute grâce au partage. Mais surtout, ne rentrons pas dans les
Balkans, ne remontons pas dans le temps si plastique des cartographies, des
dessinateurs de frontières avec leur poker menteur. Mieux vaut rester entre
nous, ici, en France. Que serait un Hexagone à cinq côtés ? quatre, comme un
cercueil ? on n’ose poursuivre l’émiettement, si semblable à celui de l’Europe,
qui à ce titre rejoue à grande échelle l’opposition Jacobins/Girondins (pour ne
pas parler des Blancs). ASIIRE, donc. Le second I, pour identitaire, fait mal.
C’est sa raison d’être. Jadis et naguère, on disait facho. Mais l’emploi s’est
oralisé. Par écrit, on est censé prendre le temps de penser, de tourner sept
fois en l’air ses doigts avant de taper sur le clavier. Mais faut-il entendre :
identitaires comme l’antonyme d’altéritaires ? Doit-on postuler, dans un
argumentaire bien ficelé, deux grands partis, deux grandes postures, ceux qui
défendent le même, et leurs opposés ? La question mérite d’être posée car elle
montre qu’«identitaire» est une insulte plus qu’un concept. Son emploi fait
l’économie d’une pesée dialectique. C’est un terme cartouche. Je préfère celui
de facho : les «identitaires» sont des fachos, point barre. Comme en cuisine,
réservons le terme potentiellement dialectique en soi pour des plats plus fins.
Donc, fachos et identitaires mis à part, de quoi (et non de qui) parlons-nous ?
De ce qui agite les méninges des catastrophistes de toujours ? Chaque année
suivant le grand tremblement de terre dit de Lisbonne (Fès aussi s’est
écroulée), en 1755, des prophètes se levaient qui annonçaient, le jour
anniversaire, la fin du monde. L’exemple est bon car il est ancien. Il illustre
une attitude mentale courante, pour ainsi dire, une constante anthropologique,
et non une position intellectuelle, de caractère idéologique ou politique. À la
rigueur, on insistera sur le caractère religieux de tels phénomènes, mais la
notion de religiosité s’applique à toute conduite de type rituel, gestes et
pensées profanes inclus : on peut respecter religieusement la constitution
laïque de la République française. En latin, relegere est l’antonyme de
neglegere.
Restons donc entre nous. La France d’outre-Loire et Couesnon est notre
objet. Notre objet chéri : n’avons-nous pas quelques attaches profondes, disons
des liens, pour ne pas tomber dans le racinaire qui, par étymologie, tombe dans
le radical, ni l’identitaire, dont nous savons à quoi nous en tenir. C’est ce
chérissement qui importe : jusqu’où peut-on aller par empathie, par adhésion
spontanée, ou encore, pour parler comme les moralistes vieille France, par le
cœur, la passion ? Certes, il faut tête froide garder : la constitution est là
pour mettre un frein aux passions désordonnées du citoyen tel qu’en lui-même et
de la communauté à laquelle il appartient. Mais que faire lorsque le cœur d’un
habitant d’une région lui dicte un amour, non pas forcément supérieur, mais plus
intense pour celle-ci à l’amour qu’il doit porter à l’ensemble des régions dont
l’État est formé ? Un amour à deux étages est-il la seule solution ? Le principe
de subsidiarité peut-il dicter des attitudes affectives ? Car c’est bien cet
ordre de phénomènes qui affleure, par en dessous donc, et dont il s’agit dans
nos positions assumées, raisonnées, ouvertes au débat. Le primum mobile du
politique, c’est la passion, mais elle n’en est pas le dernier mot, sinon il n’y
aurait pas de politique. Le calcul vient toujours après. Dès lors une passion
n’est pas ethnique. La gardienne et le gardien voient mal dans cette nuit entre
chiens et loups et où tous les chats sont plus que gris.
L’ethno-régionalisme
n’est pas une variante du régionalisme. C’est un concept formé par des
géographes des années 1960. C’est une approche géocentrée sur le niveau micro de
la région. Ainsi les recherches de David Maynard, un New Yorkais devenu Rennais
pendant deux ans, portent sur le «mouvement social ethnorégionaliste breton».
Compte rendu de sa thèse de 1991, Ideology, collective action and cultural
identity in the Breton movement, western France, (Faculté d’anthropologie de
l’université de la ville de New York) : «Sur la base d'un travail
anthropologique de terrain mené en 1985-1987, les interconnexions entre la
production d'idéologie, l'action collective et les expériences de vie
des participants au mouvement sont examinées afin de construire un récit
holistique d'une culture de résistance contre-hégémonique.» Trente ans plus
tard, l’ethnorégionalisme, de catégorie anthropologique, est traité sous la
plume du gardien de la forteresse de l’Une-et-indivisible comme une catégorie
politique dépréciative. C’est la jonction de l’ethnique et du régional qui fait
plaie : ethnie égale identité, région égale anti-nation. Un juriste qui clame sa
spécialisation en droit constitutionnel se doit d’éviter les amalgames. Chaque
mot simple compte, chaque mot composé se décompte. Faisons comme Stendhal : lire
le Code civil avant de s’endormir. L’ennemi, c’est la boursouflure sémantique.
Back to fundamentals : la préférence pour le local. Pour Miguel Torga,
l’universel, c’était le local moins les murs.
Quand ce local est à forte
détermination culturelle, dont l’existence de pratiques linguistiques
différenciées, menacées ou non, avec la richesse expressive que cela entraîne
dans tous les domaines de la vie, il ne faut pas s’étonner que fleurissent des
formes d’expression, de reconnaissance et de revendication tout aussi
différenciées. Le politique étant le niveau conceptuel ultime par lequel se
débattent et se décident les destinées collectives, il ne faut pas non plus
s’étonner, voire à crier au loup, que les passions de cet ordre prennent place,
cherchent à se faire entendre et à influencer le cours des choses, à l’évidence,
démocratiquement.
Le gardien et la gardienne aiment à faire rimer leur rôle avec
historien et historienne. L’historien (masculin de généralité) est comme le
poète, il a toujours raison. En revanche, sa raison n’est pas dans les mots,
mais dans les faits. Et le fait est que l’ethnorégion Bretagne a donné dans la
peste brune. Mais est-ce la couleur de fond du puzzle ? en a-t-il toujours été
ainsi ?
Oui, les fachos sont là, en 2023, oui, une marée brune s’observe, qui
incruste ses dépôts quand elle semble se retirer pour un moment. Oui, des
Bretons ont collaboré avec les nazis, les uns, par la plume, les autres, une
centaine, la mitraillette. Et avant de collaborer, ils ont tenu des propos
aujourd’hui inacceptables et impardonnables. Oui, ceux-là ont franchi le
Rubicon, prenant pied sur le territoires des papes de la haine et de la
violence. Oui encore, et toujours, les non-assez-épurés (avec Pierre Hervé, on
se rappelle que la Libération a été trahie (1) ont repointé le bout de leur nez,
plume et mitraillette en moins. Les uns, responsables de leurs paroles, les
autres, de leurs actes. Mais sont-ce ces paroles et ces actes qui donnent leur
couleur aux paroles et aux actes de la génération suivante ? Les enfants,
petits-enfants, redevables à leurs pères et mères (des femmes aussi ont surfé
sur la marée brune de la Seconde Guerre mondiale) ? Les inquisitions ibériques
ont condamné des chrétiens, dits alors chrétiens nouveaux, parce que leurs
arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents avaient été juifs. Comme si (une
locution peu historienne) la génération des lendemains de guerre avait été
élevée dans l’entre-deux-guerres.
Mais cette histoire-là ne date pas d’hier.
Elle est précisément l’histoire qu’ont commencé à écrire ceux de cette
génération, et ce, bien avant le gardien et la gardienne. Pour faire bref, Alain
Déniel l’avait prévu dans son livre édité chez Maspero voilà presque un
demi-siècle : «Bien des esprits se trouvèrent portés à assimiler le mouvement
breton à la collaboration ou même à ne voir dans l’Emsav qu’une création de
l’Allemagne hitlérienne […], une séquelle du nazisme.»
La Bretagne a droit à une
mémoire un peu plus longue, étoffée, et débarrassée des hardes de ces soldats de
néant. Juste deux exemples. Ce ne sont pas forcément des Bretons dits de souche
(gardons les racines pour les mots) qui ont porté haut son particularisme. Dans
les années 1570, un médecin normand, Roch Le Baillif, y croyait dur comme fer
et, pour honorer la jeune province, il l’a dotée d’un fondateur nommé Armoreus,
fils d’Énée, celui de Rome, tout en épousant la thèse du breton comme langue
d’origine grecque défendue par l’historien de la Bretagne, Alain Bouchart. Ce
cocktail bien à la mode de l’époque reflète et l’absence des murs et le choix du
local. Ça n’empêche pas l’amour des vieilles pierres : «Ce sont les gens de
boutique qui corrompent le plus la Bretagne. […] On fait sauter les rocs un peu
partout. […] C’est à présent, de tous côtés, les hôtels, les hangars, les
bicoques d’Asnières et d’Ostende.» André Suarès à Albert Chapon, 5 septembre
1911. Pour un peu, en 1970, le juif breton de Marseille aurait plastiqué un
bulldozer à remembrement.
 |
| André Suarès, "L'adieu", Le livre de l'émeraude (Calman-Lévy, 1902) ; eau-forte gravée par Auguste Brouet dans l'édition de 1927. |
Mais de tous ces chansonniers et plumitifs, qu’est-ce
qu’on va en faire ? De l’auteur du Recit var ar victor glorius gounezet gant ar
bobl a Baris e mis c'hoevrer 1848, evit souten hon liberte hac hor guirion
legitim [Récit de la victoire remportée par le peuple à Paris en février 1848 en
soutien de nos liberté et légitime vérité] imprimé à Morlaix cette année-là ? ou
des chants des sardinières de 1926 ? ou encore, où fourrer Louis Guilloux ? et
ceux-ci, les porteurs de gwenn ha du enrubannés de rouge, rue de Siam ou Le Bastard ? Mais ce ne
sont là qu’individus et groupuscules. Que faire de la masse qui agite le fanion
bicolore, écrase le pied du voisin dans une fisel ? Entonnons un Bro yaouank ma
bugale et laissons donc le gardien et la gardienne à leur affût. Tant qu’elle
fait de l’histoire, nul mal à cela, encore faut-il apporter du nouveau, pas
seulement une rage généralisatrice supra-générationnelle. Bah, on comprend le
meurtre du Per, il y avait bien de quoi ester en justice. Mais de là à finir par
railler les exilés de Paris, ces faux Bretons, et puis quoi encore ? Déjà que
les Français de l’étranger, comme la main, n’ont jamais eu bonne presse. Et puis
il y a tous ceux que la gardienne affuble du sobriquet de «barde» (les Gallois
respectent les leurs) – des Bretons nouveaux, comme il y eut des chrétiens
nouveaux ? –, grossissant, dans la meilleure tradition du pamphlet, silhouettes
et poils de barbe, la génération des chanteurs qu’applaudissaient grévistes du
Joint français et marcheurs du Trégor en défense de la langue de leurs pères et
mères ? En définitive, côté fachos, l’état d’alerte subsiste, s’intensifie même.
Mais côté histoire, le gros du travail n’est pas venu de leur tour
Quiquengrogne. Il y a des comptines à raconter e brezhoneg ivez, et c’est ce qui
devrait fuser des mâchicoulis plutôt que des boulets sur les alliés objectifs.
 |
| "C'est une rapsodie foraine / Qui donne aux gens pour un liard / L'Istoyre de la Magdalayne, / Du Juif-Errant ou d'Abaylar." (Tristan Corbière, Le Pardon de Saint-Anne, bois de Malo Renault, 1920.) |
1 - Hervé, Pierre, La Libération trahie, Grasset, 1945.
Yeun Sterneñv, 1.12.2023