Il y a quatre ans,
dans mon ouvrage « Agents du Reich en Bretagne » (Skol Vreizh, 2011),
j’avais consacré un chapitre – dont j’extrais quelques passages – à l’histoire
du groupe Gallais de Fougères et rencontré Huguette Gallais qui a bien voulu évoquer ses années en camp de concentration. Son témoignage me
semblait irremplaçable, car jamais les archives ne restitueront les souffrances
et le courage dont ont fait preuve ces résistantes et résistants de la première
heure tout au long de leur déportation. Avec Huguette Gallais s’éteint une des
dernières voix de la Résistance en Ille-et-Vilaine et plus particulièrement à Fougères qui compte deux établissements scolaires portant le nom de deux grandes résistantes : le collège Thérèse Pierre et l'école Odile Gautry.
En juin 1940, les Allemands n’avaient pas encore
franchi les limites de l’Ille-et-Vilaine que les membres du groupe Gallais, dans une démarche spontanée
et isolée, décidèrent de récupérer les armes abandonnées lors de la débâcle
dans l’idée de s’en servir plus tard contre l’occupant. Cette implication du
pays de Fougères dans la
Résistance ne se démentira pas tout au long du conflit,
notamment autour des carrières d’extraction du granit, nombreuses dans la
région, mais aussi jusqu’à la mine de Vieux-Vy-sur-Couesnon. Leurs stocks d’explosifs
seront très convoités par les FTP de Louis Pétri,
alias « commandant Tanguy », bien implantés dans le secteur.
Voyant ces soldats briser leurs fusils sur les murs
du château médiéval de Fougères dont il était le gardien, René Gallais, aidé de sa femme et de sa
fille, va tout faire pour les récupérer avant l’arrivée des Allemands.
Convaincu qu’elles serviront plus tard contre l’ennemi, il les cache dans une
des tours du château. Passé l’armistice, et les occupants installés durablement
en ville, la priorité de René Gallais sera de transférer ces armes dans des
cachettes plus sûres. A cet effet, quelques patriotes possédant des véhicules
sont contactés et leur transport dans les villages alentours s’organise. C’est
ainsi que se met en place le groupe Gallais avec l’aide de François Lebossé à Laignelet et Jules Frémont, transporteur à
Saint-Brice-en-Coglès. L’ensemble atteint
rapidement une cinquantaine de personnes. Quelques mois plus tard, pendant les
vacances d’août 1941, le directeur de l’école Saint-Sulpice et sa femme, amis
de la famille Gallais, reçoivent leur beau-frère et un de ses amis. Ce dernier
n’est autre qu’Albert Chodet, ancien combattant de la Première Guerre
Mondiale, capitaine et membre du mouvement Ceux de la Libération (CDLL) situé
à Neuilly-sur-Seine. Parmi les différents
mouvements de résistance, CDLL, qui fut l’objet d’une implacable répression de
la part des nazis, est l’un des moins connus. Il a été créé au début de l’été
1940 par Maurice Ripoche, un ancien pilote de chasse
qui va surtout recruter parmi les officiers de réserve, issus notamment de
l’Armée de l’Air. Politiquement, ces résistants sont plutôt de droite. René
Gallais, qui connaît désormais Albert
Chodet, est catholique, comme la
plupart des membres du groupe. Cependant, le mouvement CDLL se convertira
progressivement à la démocratie. Ses membres s’occupent essentiellement de la
recherche de renseignements, y compris à Vichy, mais ils participent aussi
aux évasions et à l’action paramilitaire. A la suite de cette rencontre entre
le capitaine Chodet et René Gallais, le groupe intègre le réseau
CDLL et entre en liaison avec Paris. René Gallais, qui ne peut plus exercer son
métier de guide au château du fait de l’Occupation, devient employé de la
Mairie et en profite pour fabriquer des faux papiers et fournir des cartes
d’alimentation aux prisonniers évadés. L’activité du groupe Gallais ne se
résume pas seulement à la récupération d’armes, ses membres relèvent également
les emplacements des dépôts de munitions ou d’essence installés par les
Allemands, ces informations devant ensuite être transmises en Angleterre.
Marcel Lebastard, un jeune étudiant de 22 ans,
est chargé de cette mission : « Au
cours de l’été 1941, étant en vacances chez mes parents à Fougères, M. René Gallais, connaissant mes sentiments anti-allemands,
me demanda d’entrer dans son organisation et de m’occuper de rechercher
l’emplacement des dépôts d’armes allemands pouvant exister dans la région. Je
connaissais à peine les autres membres de l’organisation dont M. Gallais était
le chef et je ne connaissais pas du tout (Le couple dénonciateur). Je n’ai jamais
été, je crois, en contact avec eux avant mon arrestation par les Allemands, à
Fougères le 9 octobre 1941. C’est seulement 10 jours après mon arrestation, à
la prison d’Angers où
j’avais été transféré que j’ai su exactement ce que l’on me reprochait. J’avais
établi le plan d’un dépôt de munitions qui se trouvait près de Mi-Forêt, en
forêt de Rennes et
j’avais remis ce plan à M. Gallais pour
qu’il le fasse parvenir en Angleterre. »
Au printemps
1941, un jeune couple, originaire des Côtes-du-Nord, et dont l’homme venait
régulièrement à Fougères séjourner chez une tante commerçante rue de la
Pinterie, s’attire la confiance de la famille Gallais. Se faisant passer pour
un membre de l’Intelligence Service, cet agent des Allemands infiltre le
groupe. Ce qui va se passer ensuite n’était alors que trop prévisible.
La chute du
groupe gallais
Le 9 octobre 1941, dès 6 h du matin, les Allemands
débarquent au domicile de la famille Gallais. Alors qu’ils fouillent le
rez-de-chaussée, Huguette, qui les a entendus, cache un pistolet dans la
gouttière et des papiers compromettants dans les toilettes. Elle tire la chasse
d’eau. Alerté par le bruit, un Allemand monte et découvre la jeune fille qui
fait semblant de dormir. Les Allemands fouillent le reste de la maison. Andrée
Gallais a caché trois pistolets dans un seau
d’épluchures. Pendant toute la perquisition, un soldat allemand assis sur le
rebord de la fenêtre, balance son pied au-dessus du seau. La famille Gallais est emmenée Place d’Armes avec une cinquantaine
de membres du réseau. Ils sont ensuite enfermés dans des chambres de l’Hôtel
des Voyageurs avant que les cars allemands ne les transfèrent à Angers via Rennes. Au moment de leur départ,
les Fougerais sont très nombreux sur la place et entonnent la Marseillaise. Les
Allemands chargent et les repoussent. Gérald
Gallais, le jeune frère d’Huguette,
est libéré immédiatement faute de preuves. Une tante de Pontorson vient le chercher. Sous prétexte d’aller
récupérer des vêtements et des affaires d’école, il récupère les trois
pistolets qu’avait cachés sa mère, les cache dans son cartable et les dépose
chez Joséphine Caillet, membre du groupe.
Dès l’aube donc,
de ce jeudi 9 octobre, les Allemands procèdent à plusieurs arrestations et
perquisitions. Ils ne vont pas n’importe où car tout semble indiquer qu’ils ont
la liste exacte des suspects qu’ils doivent appréhender. La famille Gallais est
la première visée : « Nous
fumes arrêtées, en même temps que M. Frémont, de Saint-Brice-en-Coglès, M. Lebossé, M. et Mme Pitois et
d’autres, en tout quatorze, le 9 octobre 1941, à la suite d’une mission exécutée
la nuit même. Le matin, des Allemands, venus perquisitionner nous emmenaient à
la Kommandantur où nous restions toute la journée pour subir un interrogatoire
dont le résultat resta négatif pour les Allemands, bien entendu. Pourtant nous
fûmes transférés dans la prison d’Angers. Et c’est là, à Angers (que l’homme et la
femme agents des Allemands) arrêtés avec nous, furent libérés. Pourquoi ?
Le premier doute nous vint de là. Et depuis, nous avons eu confirmation et
pouvons certifier maintenant que ce sont eux qui, pour un motif qui ne peut
être que l’appât de l’argent à gagner (100 000 F par tête
paraît-il) nous ont dénoncés. »
Le
regroupement à l’Hôtel des Voyageurs
Toutes les personnes interpellées ce jour-là, soit un
peu plus d’une cinquantaine, sont immédiatement emmenées à l’Hôtel des
Voyageurs, réquisitionné par la Feldgendarmerie, pour y subir leurs premiers interrogatoires.
Arrêtée à son domicile face au château, Huguette Gallais se rappelle avoir remonté à pied la rue de la
Pinterie, encadrée par des soldats en armes.
C’est vers la
prison d’Angers que les patriotes fougerais sont transférés le
soir même de leur arrestation à bord de deux autocars. Huguette Gallais se souvient qu’il faisait encore jour, puisque
les ouvriers des usines de chaussure, ayant appris les arrestations en quittant
leur travail, se regroupèrent devant le tribunal de Fougères, place Gambetta, face à
l’hôtel des Voyageurs. Ne pouvant s’interposer, ils ont entonné la Marseillaise.
La déportation
en Allemagne
Des 55 personnes arrêtées le 9 octobre, 41 sont relâchées à partir
du 26 octobre. L'affaire se présente on ne peut plus mal. Le 20 octobre en effet, à Nantes, le lieutenant-colonel Karl Hotz est abattu par des résistants, avec les conséquences que l'on connait. Les quatorze autres, considérées par les Allemands comme le
noyau dirigeant du groupe, restent détenues à la prison d’Angers. A la mi-novembre, les onze
hommes sont transférés à la prison de Fresnes, tandis que les trois femmes
sont dirigées sur celle de la Santé. Le 18 décembre 1941, les
quatorze patriotes sont déportés vers Augsburg, ville située à l’ouest de la
Bavière, en attendant d’être jugés par le Tribunal du Peuple
(Volksgerichtshof). Jugement qui n’interviendra que le 23 février 1943, soit
après 14 mois de mise au secret.
Des quatorze prisonniers, ils ne sont plus que douze
à comparaître lors du procès tenu le 23 février 1943 à Munich. En effet, Joseph Brindeau, tuberculeux, est décédé dans
sa cellule le 30 mars 1942, par manque de soins. Quant au gendarme Jagu, faute de charges
suffisantes, iléchappera au tribunal et sera libéré plus tard. Tous sont
condamnés à mort : Jules Frémont, René Gallais, François Lebossé, Raymond Loizance, Antoine Perez, Marcel Pitois, Louis Richer, Jules Rochelle, Marcel Lebastard, Andrée Gallais, sa fille Huguette et Louise
Pitois. Trois avocats ont été désignés pour « défendre » les accusés.
Huguette Gallais, qui comprend un peu
l’allemand, fut étonnée d’entendre l’un de ceux-ci, le docteur Reisert, plaider en faveur de son
père, comme lui ancien combattant de la Première Guerre Mondiale. Reisert sera arrêté par les nazis puis
libéré par les Américains en 1945.
Parmi les douze condamnés à mort, huit hommes : Jules
Frémont ; René Gallais ; François Lebossé ; Raymond Loizance ; Antoine Perez ; Marcel Pitois ; Louis Richer et Jules Rochelle seront transférés à la prison
« Stadelheim » de Munich le 9 septembre 1943. Le 21 septembre 1943, les
huit résistants seront décapités entre 17 h et 17 h 30. Tous ont reçu la
communion par l’aumônier de la prison avant d’être exécutés. Sanction terrible pour des résistants qui n'ont jamais tiré le moindre coup de feu ni tué qui que ce soit.
Andrée Gallais, sa fille Huguette et Louise
Pitois seront graciées, ainsi que le
jeune Marcel Lebastard. Les trois femmes et le jeune
homme vont transiter de camps de travail en camps de concentration jusqu’à la
capitulation du Reich. Louise Pitois, 41 ans, trop épuisée, va
décéder le 10 mai 1945 au camp de Bergen-Belsen, juste avant son rapatriement
prévu par les Américains. Ne réchapperont donc de l’horreur des camps nazis
qu’Andrée Gallais, sa fille Huguette et Marcel
Lebastard.
Tout au long de leur calvaire concentrationnaire,
Huguette Gallais, sa mère et Louise Pitois, resteront ensembles :
« Nous ne faisions qu’une. Dès que
l’une d’entre nous flanchait, les deux autres la soutenaient. A Mauthausen, les Allemands voulant l’emmener, je me
suis couchée sur Louise Pitois, pour empêcher qu’elle soit séparée de nous. » Pesant à peine
trente kilos lors de sa libération, Andrée Gallais, 45 ans, sera la plus
affaiblie, au point de rentrer à Paris sur une civière : « Je ne me souviens plus des dates de mes
transferts dans les différentes résidences où j’ai été incarcérée. Mais comme
partout, j’ai suivi ma fille, je me rapporte à ce qu’elle vous a indiqué (…)
J’ai été condamnée à mort plusieurs fois à l’audience du 23 février 1943 à
Augsburg ; pendant trois mois à Munich j’ai
été au secret spécial des condamnés à mort et ma condamnation n’a jamais été
commuée. Le dernier camp où j’ai séjourné c’est celui d’extermination de
Mauthausen où
j’ai été libérée le 22 avril 1945 par la Croix-Rouge suisse. Pendant toute ma détention, j’ai subi
des sévices de toutes sortes, longs interrogatoires, menaces, privations de nourriture ;
pendant un an j’ai été au secret en cellule. Quand j’ai été en camp de
concentration, j’ai été astreinte aux travaux les plus pénibles. Pendant que
j’étais aux travaux forcés, je travaillais dans l’eau pour laver le maïs. On
nous enfermait dans une salle où se trouvaient les barils contenant l’eau et le
maïs dans une atmosphère telle que la surveillante ne pouvait elle-même rester
dans la salle. Elle sortait et nous enfermait à clef. J’ai fait naturellement
de la dysenterie et de la paratyphoïde. Comme toutes les femmes que les
Allemands employaient à des travaux pénibles, j’ai eu une descente d’organes.
Pendant que nous étions à Mauthausen, souvent la nuit on réquisitionnait des
femmes pour des scènes d’orgies. »
Plus jeune, Huguette Gallais, 24 ans, se souvient
parfaitement des camps où elle fut internée : « Je suis restée à la prison d’Angers du 10
octobre au 15 novembre puis transférée à la Santé jusqu’au 18 décembre, de là à Augsburg où je
suis arrivée le 22 décembre. Je suis restée au secret pendant 14 mois, ma mère
pendant un an et mon père pendant 18 mois. J’ai été condamnée à mort et jusqu’à
ma libération, en suspension d’exécution ; ma condamnation à mort est du
23 février 1943. J’ai quitté Augsburg le 9
septembre 1943 pour Munich où je
suis restée au secret spécial des condamnés à mort jusqu’au 19 novembre 1943. A cette date je suis
partie pour le bagne de Lübeck en
passant par la Pologne avec des arrêts à Thorn, Posen. Le voyage a duré cinq semaines. Nous
sommes arrivés à Lübeck le 18
décembre 1943 jusqu’à Pâques 1944. De là, envoyées au bagne de Cottbus en
passant par Stettin. Nous avons quitté Cottbus pour
être conduits au camp de concentration de Ravensbrück où nous
sommes restés jusqu’au 28 février 1945, nous en sommes parties pour le camp
d’extermination de Mauthausen où nous avons été libérées le 22
avril 1945 par la Croix-Rouge suisse. Pendant mes interrogatoires et toute
ma détention, j’ai été l’objet de mauvais traitements, de privations de
nourriture et de travaux forcés. »
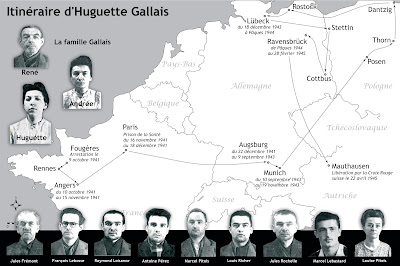 |
| Kristian Hamon, Agents du Reich en Bretagne, Skol Vreizh, 2011. |
Huguette et sa mère ne feront qu’un bref séjour à Fougères avant d’être accueillies par de la famille à Pontorson. Alors que ses souvenirs des arrestations et de sa déportation sont intacts Huguette ne se rappelle plus de son retour à Fougères. Sinon qu’elle se revoit, encore vêtue de sa tenue de déportée avec ses sabots, en haut de la rue de la Pinterie d’où on lui montre le château. Tout a été bombardé, la rue est détruite, ainsi que sa maison, située tout en bas, face au château. Plus tard, les deux femmes seront relogées dans une baraque installée sur l’emplacement de l’ancienne maison.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire